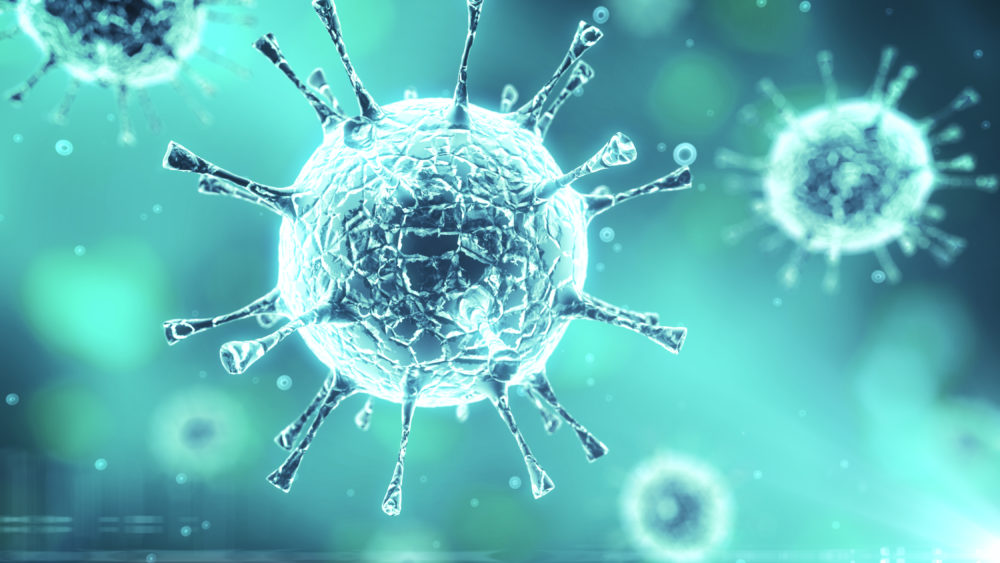Par Franck Amiot
Selon un adage bien connu, les brevets sont un moteur de l’innovation, en ce qu’ils garantissent un retour sur l’investissement consenti à la recherche et au développement des produits. Cette disposition semble particulièrement applicable au domaine pharmaceutique, où les temps de développement des produits thérapeutiques et leurs coûts sont présentés comme les plus élevés. À tel point qu’il n’est pas concevable de développer un principe actif sans une protection par brevet et qu’à l’inverse, si la protection par brevet se révèle impossible, l’investissement reste limité, voire inexistant. On regrette alors parfois que les produits publiquement disponibles soient délaissés faute de permettre un monopole, suggérant ainsi que l’absence de brevet nuirait à l’innovation.
Il ne fait aucun doute que brevet et innovation sont intimement liés. Le brevet offre un cadre légal permettant à une invention de grandir et d’accéder à son marché. Cependant, d’autres dispositifs concourent au développement de l’innovation, qu’ils soient financiers, fiscaux ou organisationnels, à commencer par les start-ups, les pépinières d’entreprises, les diverses institutions de soutien à l’innovation, les subventions nationales et européennes et les groupes d’investissement privés. Dans le cas des produits pharmaceutiques, l’exclusivité des données, et le cadre réglementaire en général, joue également un rôle crucial. Ainsi, l’innovation bénéficie d’une infrastructure complète, au point qu’il peut être difficile de déterminer la part des brevets, par rapport aux avantages offerts par l’écosystème économique, dans la réussite d’un projet.
Il est même fort probable que le brevet à lui seul ne suffirait pas à soutenir l’innovation et encore moins à l’initier, car c’est avant tout une dépense supplémentaire, engagée très tôt dans le projet et à priori préjudiciable au développement du projet lui-même, et qui produit ses effets bien plus tard, en général au moment de la commercialisation. Le brevet prend alors tout son sens en cas de succès commercial, dont il permet de maximiser les revenus.
Le brevet apparaît donc comme un marqueur de l’innovation, à laquelle il est presque systématiquement associé, plutôt que comme un de ses moteurs. Le nombre de brevets est d’ailleurs un critère de choix pour évaluer les efforts d’innovation d’une entreprise ou d’un pays, bien que ce critère soit parfois discuté pour ne pas tenir compte de la réelle pertinence ou de la qualité des inventions protégées.
À ce titre, une recherche rapide des demandes de brevet comprenant le terme « COVID-19 » sur la base de données publique PATENTSCOPE, donne près de 2000 occurrences toutes publiées entre 2020 et 2021. Il apparaît alors indéniable qu’une intense activité a débuté dès l’émergence du virus en 2019, si l’on tient compte du délai de 18 mois avant la publication des demandes de brevet.
En comparaison, Les demandes de brevets comprenant le terme H5N1, dans cette même base de données, sont moins de 1000, dont la publication s’étale de 2005, date d’émergence de la grippe correspondante chez l’homme, jusqu’à aujourd’hui en 2021. Seule une soixantaine de demandes de brevet ont été publiées entre 2005 et 2007, et environ 130 entre 2005 et 2008. La différence est grande par rapport aux 2000 demandes relatives au COVID 19 déjà publiées.
Il est entendu que dans ce cas, le moteur de l’innovation n’est pas tant le brevet que le besoin et l’urgence de solutions thérapeutiques. L’intensité de la crise du COVID-19 et ses perspectives en termes de durée, sans commune mesure avec celles de la grippe aviaire de 2005, se reflètent dans le nombre accru de demandes de brevet. Selon cette lecture, la pandémie de COVID-19 est bien plus incitative que celle du virus H5N1, de par sa gravité, son étendue et les menaces qu’elle fait encore peser.
Mais elle est également incitative du point de vue des possibles retours sur investissements. À ce titre, le nombre de brevets révèle avant tout les espérances de maximiser les profits d’un futur blockbuster. Si l’on considère en effet le temps nécessaire à la recherche scientifique pour établir une solution spécifique ex nihilo, il est très improbable qu’elle apparaisse dès l’émergence de la pandémie, comme ce fut le cas des brevets. De fait, le nombre important de demandes de brevets publiées depuis 2019 sur le sujet reflète davantage la protection des savoirs déjà développés, pour une éventuelle utilisation contre le COVID 19, que les efforts de recherche sur la maladie elle-même. Cela ne signifie pas forcément qu’il n’y a pas de réels efforts de recherche, mais que ces éventuels efforts ne peuvent pas raisonnablement être à l’origine des demandes de brevet publiées à ce jour.
Considérer le brevet comme un moteur de l’innovation apparaît donc dans ce cas incorrect. Le considérer comme un marqueur de l’innovation est peut-être plus juste, bien que la recherche de fond soit le plus souvent l’apanage des institutions publiques, et peu propice aux brevets. Le nombre de brevets, à lui seul, ne permet pas non-plus d’évaluer la qualité ou la pertinence des inventions correspondantes. Le brevet ne vise pas tant la qualité d’une invention que la qualité de sa protection.
En revanche, le brevet se révèle ici tel qu’il est conçu, c’est-à-dire un outil stratégique efficace permettant de maximiser d’éventuels profits. Il s’agit alors de prendre date rapidement, le plus souvent à titre spéculatif. Dans ce contexte, si le rôle moteur du brevet dans l’innovation apparaît discutable, il participe largement à sécuriser les investissements consentis fasse à une nouvelle opportunité commerciale. La question reste entière quant à de tels investissements en l’absence de brevets, même en cas de crise sanitaire. En effet, l’opportunité commerciale seule pourrait ne pas suffire à réorienter les efforts de recherche vers une solution efficace, surtout si elle apparaît éphémère ou temporaire. Sans la garantie des brevets, et probablement d’autres garanties offertes par l’infrastructure économique, il est probable que les vaccins n’auraient pas été si promptement produits. Nous notons à cette occasion la grande réactivité et l’agilité de l’industrie pharmaceutique à réorienter ses stratégies dans la direction de l’avenir, faisant des brevets l’aiguille de leur boussole.